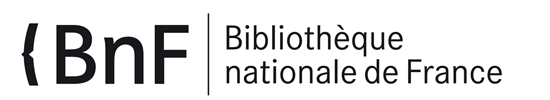|
|
|
1. Appel général : Sujets proposés par les départements > Histoire du livre & de l’éditionL’édition des romans de chevalerie à Paris au XVIe siècleLes romans de chevalerie occupent une place de choix dans la production éditoriale en langue vulgaire au XVIe siècle. Les études littéraires qui les concernent sont aujourd’hui nombreuses mais n’en font que plus vivement ressentir le besoin d’un instrument bibliographique décrivant de la manière la plus exacte possible la production parisienne, indispensable complément aux descriptions que propose, pour la ville de Lyon, la base des Éditions lyonnaises de romans du XVIe siècle (1501-1600). Le travail mettra à profit l’information bibliographique fournie par des instruments tels que le Nouveau répertoire de mises en prose (XIVe-XVIe siècle), Maria Colombo Timelli, Barbara Ferrari, Anne Schoysman et François Suard (dir.), Paris, Classiques Garnier, 2014, ou le site des Archives de littérature du Moyen Âge, afin d’identifier les textes et les grandes branches de leur tradition et de définir un plan de travail qui permette de couvrir le corpus par tranches successives. Pistes de recherche : effectuer un recensement des éditions existantes, décrire pour chaque texte les relations d’une édition à l’autre, identifier le matériel iconographique mobilisé dans le cas des éditions illustrées, localiser les exemplaires connus dans les collections publiques. Contact : Jean-Marc Chatelain, directeur de la Réserve des livres rares 01 53 79 54 50, jean-marc.chatelain@bnf.fr Les autrices culinaires et gastronomiques de la fin du XVIIIe siècle à nos joursLes plus anciens livres de cuisine français connus sont pour la plupart anonymes : lorsqu’ils sont signés, c’est toujours par des noms d’hommes. La Cuisinière républicaine (1794) est le premier traité de cuisine attribué à une femme, Madame Mérigot, sur laquelle des recherches restent à conduire. Le début du XIXe siècle est marqué par la publication de plusieurs ouvrages signés par des femmes dont l’existence est attestée : Louise-Augustine Friedel, Marie-Armande Gacon-Dufour, Aglaé Adanson, Marguerite Spoerlin. À la suite de ces ouvrages, de nombreux traités de cuisine signés de noms de femmes, bien que parfois écrits par des hommes, voient le jour. A la fin du XIXe, plusieurs femmes, à l’instar de Marie Saint-Ange ou Marthe Distel, participent ou fondent des journaux culinaires. C’est parfois à travers la cuisine que les femmes se font progressivement une place dans le monde du journalisme ou de l’édition. L’avènement de grandes figures au XXe siècle, comme Ginette Mathiot, Mapie de Toulouse-Lautrec ou Françoise Bernard, se traduit par des chiffres de vente spectaculaires. Ces autrices restent pourtant peu connues au-delà de leur pseudonyme. Le travail de recherche consistera à enquêter sur ces ouvrages afin d’en retracer l’histoire, de comprendre à qui ils étaient destinés et qui les a écrits. Il s’agira ensuite d’approfondir la connaissance des autrices identifiées. Si le projet portera principalement sur le fonds conservé par le département Sciences et techniques, il sera étudié en relation avec d’autres collections conservées à la BnF (collections gastronomiques, manuels d’éducation des filles, presse culinaire, presse féminine et féministe, etc.). Des recherches complémentaires pourront être conduites au sein des archives publiques ou d’archives privées d’éditeur. Pistes de recherche : histoire du livre et de l’édition, histoire de l’alimentation, sciences de l’information et de la communication. Plusieurs approches sont envisageables : statistique, typologique, prosopographique, etc. Contacts : Valérie Allagnat, directrice du département Sciences et techniques 01 53 79 51 50, valerie.allagnat@bnf.fr Référente scientifique : Isabelle Degrange, chargée de collections Les Manuels RoretAu début des années 1820, le libraire et éditeur Nicolas-Edme Roret (1797-1860) commence à publier une série de manuels thématiques tant professionnels que de vulgarisation. Cette collection de poche va prendre une ampleur inattendue : poursuivie par son fils Nicolas Roret (1834-1894) puis par plusieurs éditeurs successifs, les Manuels Roret puis Encyclopédie Roret vont rassembler plusieurs centaines de titres, aux nombreuses rééditions. Ils traitent tant du fabricant de papier que du phrénologiste, du toiseur de bâtiments que de la politesse et de la bienséance : https://gallica.bnf.fr/blog/01022018/les-manuels-roret. Cette collection est emblématique du secteur de l’édition dédiée à la vulgarisation. Son format de poche, ses sujets très variés, son faible coût dû à des tirages importants en assurent une large diffusion. Les rééditions montrent l’évolution des disciplines au fil des décennies. Deux siècles après leur création, certains volumes sont encore employés par des professionnels. Cette collection a été reçue par dépôt légal mais la diversité de ses thématiques fait qu’elle est présente dans plusieurs départements thématiques, essentiellement dans la cote V (Sciences et Arts) de la cotation Clément, conservée dans le département Sciences et techniques et dans le département Littérature et art. Le travail se fera en coopération avec ces deux départements Volumétrie : 1000 à 2000 éditions différentes Couverture chronologique : XIXe-XXe siècles Pistes de recherche :
Contacts : Valérie Allagnat, directrice du département Sciences et techniques. 01 53 79 51 50, valerie.allagnat@bnf.fr Référent scientifique : Luc Menapace, chargé de collections (sciences biologiques et paléontologie) Dans l’atelier du relieur : le matériel de trois ateliers parisiens de la première moitié du XXe siècleLa BnF conserve non seulement une collection très riche de reliures d’art, mais aussi, pour quelques grands ateliers, le matériel qui a servi à la réalisation des reliures qu’ils ont produites. La Réserve des livres rares conserve un tel matériel dans trois fonds documentant le travail d’ateliers actifs à Paris dans la première moitié du XXe siècle :
Pistes de recherche : la tâche consistera à dresser l’inventaire de ces trois fonds de matériel de reliure, à en proposer un classement et à établir les liens nécessaires entre le matériel et les collections de maquettes de reliure également conservées à la Réserve des livres rares. Contact : Jean-Marc Chatelain, directeur de la Réserve des livres rares 01 53 79 54 50, jean-marc.chatelain@bnf.fr
|