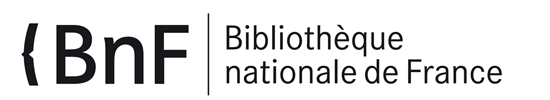|
|
|
1. Appel général : Sujets proposés par les départements > Histoire de la BnF et de ses collectionsMonnaies antiques et médiévales d’Afrique du Nord à la BnFLes collections de monnaies africaines de la BnF naissent au XVIIe siècle et n’ont cessé de s’enrichir par des achats, dons et legs, contenant probablement des trésors monétaires. Elles représentent aujourd’hui plus de 1 500 monnaies : 540 monnaies de Maurétanie, 366 monnaies numides, 772 monnaies de Zeugitane, les monnaies romaines issues de l’atelier Carthage et 188 monnaies vandales émises à Carthage. La plupart de ces monnaies ont perdu leur provenance archéologique, non précisée dans les registres d’entrée et les inventaires, et la localisation précise du lieu de découverte de la plupart d’entre elles reste incertaine. Cependant, des archives conservées à la BnF documentent de nombreux trésors découverts et les sites fouillés. Leur examen devrait donc permettre de reconstituer certains trésors et de proposer des provenances plus précises pour les monnaies du fonds. La collection comprend aussi une trentaine de trésors monétaires découverts en Afrique du Nord et conservés à la BnF, dont une partie provient d’un legs important au XXe siècle de Pierre Salama, historien et archéologue spécialiste de l’Afrique romaine. Ces trésors comptent 8 560 monnaies romaines, vandales et numides. Ils sont généralement signalés dans des publications, mais peu sont étudiés. De plus, les archives de Pierre Salama conservées à l’INHA n’ont jamais fait l’objet d’une étude en relation avec les collections qu’il a léguées à la BnF et contiennent une mine d’informations à explorer. Ces problématiques s’inscrivent dans un renouveau de l’étude du monnayage d’Afrique du Nord, marqué notamment par le projet MONOM-La monnaie dans l'Occident méditerranéen. En s’appuyant sur les registres, les archives et les inventaires, il s’agit de faire ressortir la généalogie de la collection et de mieux comprendre la répartition des monnaies sur le territoire africain, leurs usages et leurs relations avec l’histoire antique et médiévale de la région. Source : registres, archives et monnaies puniques, romaines, provinciales, grecques, numides, vandales et byzantines de la BnF. Pistes de recherches : histoire des collections, histoire de la numismatique et contextualisation, histoire économique et politique de l’Afrique du Nord. Contacts : Cécile Colonna, directrice du département des Monnaies, médailles et antiques 01 53 79 84 00, cecile.colonna@bnf.fr Référent scientifique : Ludovic Trommenschlager, chef de projet Trouvailles monétaires 01 53 79 87 24, ludovic.trommenschlager@bnf.fr Le mobilier des fouilles de Carthage par Ernest Babelon et Salomon ReinachEn 1883-1884, E. Babelon et S. Reinach effectuent des fouilles sur le site de Carthage, sur les terrains de la plaine situés entre Byrsa et les ports acquis par le cardinal Lavigerie. Les deux archéologues exhument 915 objets, dont 583 stèles puniques. Les objets recueillis dans le cadre de cette mission sont alors répartis entre le musée du Louvre et la BnF : selon les souhaits du cardinal Lavigerie, une partie des stèles puniques est en outre donnée au musée Saint-Louis de Carthage. Après le dépôt par la Bibliothèque d’un important lot de stèles puniques au musée Guimet en 1913 puis au musée du Louvre en 1950, il se trouve rester sur le site Richelieu 13 stèles, 132 lampes, 30 vases et fragments de vases, 44 objets d’os et d’ivoire, 27 objets divers, 24 marbres, 3 objets métalliques, 2 verres issus de cette mission. Les sources documentant la mission sont à la fois abondantes et de natures variées : imprimés (S. Reinach et E. Babelon, « Recherches archéologiques en Tunisie (1883-1884) », Bulletin archéologique, 1886 ; Ernest Babelon, Carthage, Paris, 1896 ; Marie-Christine Hellmann, Lampes antiques, II, Paris, 1987) et archives (partiellement numérisées, dont documentation photographique) conservées dans des institutions parisiennes : BnF (inventaires 52 et 61 du département des Monnaies, médailles et antiques), Cabinet du Corpus des Inscriptions Sémitiques, Institut de France et Institut national d’Histoire de l’art. Les candidates et les candidats sont invités à proposer un projet de recherche qui vise à documenter et améliorer le catalogage du fonds conservé à la BnF en exploitant les sources disponibles. Typologie des documents : lampes de terre cuite, céramiques, objets en os et ivoire, objets métalliques, verres, lapidaire. Contacts : Cécile Colonna, directrice du département des Monnaies, médailles et antiques 01 53 79 84 00, cecile.colonna@bnf.fr Louise Détrez, conservatrice au département des Monnaies, médailles et antiques 01 53 79 58 19, louise.detrez@bnf.fr La Bibliothèque et ses publics, du Second Empire à nos joursLa mission pour la gestion de la production documentaire et des archives conserve des sources riches et variées relatives à ses lecteurs : demandes d’accès, cartes de lecteurs, registres de prêts sous forme papier ou données d’inscription dématérialisées, statistiques des salles de lecture ou demandes de renseignements, qui témoignent de la richesse des échanges entre la Bibliothèque et ses publics. D’autres sources d’information plus contextuelles comme la réglementation, les décisions prises en comité consultatif ou les études de public peuvent éclairer la réflexion sur le lectorat de la Bibliothèque, par exemple comment la réglementation relative à l’accès à la Bibliothèque a pu permettre de répondre au problème récurrent de saturation des salles, ou comment la réflexion s’est progressivement tournée vers une ouverture au public et une extension des services rendus à ce dernier suite à l’ouverture du site François-Mitterrand. Remontant au Second Empire, qui a vu l’ouverture des salles de travail et de lecture du département des Imprimés, ces documents d’archives ont vu leur forme évoluer depuis l’informatisation de la Bibliothèque à la fin des années 1990 ou l’évolution des pratiques professionnelles au sein de la Bibliothèque avec notamment l’élaboration de rapports d’études entre la Bibliothèque et ses publics. Présentées à la séance inaugurale consacrée à l’histoire des publics du séminaire pluriannuel « Une histoire de la Bibliothèque nationale de France » organisée par les comités d’histoire du ministère de la Culture et de la BnF, ces archives restent à explorer afin de témoigner des interrogations et des enjeux qui entourent l’histoire qu’entretient la Bibliothèque nationale de France avec ses publics. Pistes de recherche : histoire administrative, histoire des pratiques culturelles, sociologie des publics Contact : Anne Leblay-Kinoshita, cheffe de la mission pour la gestion de la production documentaire et des archives ; Aurélie Outtrabady, adjointe à la cheffe de la mission anne.leblay-kinoshita@bnf.fr ; aurelie.outtrabady@bnf.fr L’histoire du dépôt légal à l’époque contemporaineLe dépôt légal constitue l’une des sources d’enrichissement des collections de la Bibliothèque. Cette histoire connaît de nombreuses évolutions juridiques élargissant notamment le champ de collecte de la Bibliothèque et assurant à l’établissement sa mission historique dans un contexte éditorial changeant. Cette riche histoire a fait l’objet de rares travaux montrant que les enjeux étaient aussi bien d’ordre politique, économique, culturel et social, mais aussi juridique puisqu’il permet de consacrer la théorie générale du droit du public à l'information. La mission pour la gestion de la production documentaire et des archives de la BnF conserve de nombreuses sources relatives à l’histoire et au fonctionnement du dépôt légal comme à son extension à d’autres supports, ainsi qu’à ses relations avec le ministère de l’Intérieur à partir de la loi du 19 mai 2025. Le travail accompli pourrait faire, le cas échéant, l’objet d’une valorisation lors d’une journée d’étude prévue à l’automne 2025 autour du dépôt légal et de son histoire dans le cadre du séminaire sur l’histoire de la BnF porté par les comités d’histoire du ministère de la Culture et de la BnF. Sources : archives conservées à la mission pour la gestion de la production documentaire et des archives, archives ministérielles conservées aux Archives nationales, collectes de témoignages auprès d’acteurs ou d’anciens acteurs du dépôt légal Pistes de recherche : histoire du droit, histoire culturelle, histoire politique, histoire économique En fonction du profil des chercheurs et chercheuses, des classements ponctuels de fonds, la création d’instruments de recherches ou la rédaction de guide de sources en articulation avec le projet de recherche sont les bienvenus. Contact : Anne Leblay-Kinoshita, cheffe de la mission pour la gestion de la production documentaire et des archives ; Anthony Roussel, archiviste/ chargé de la production documentaire numérique anne.leblay-kinoshita@bnf.fr ; anthony.roussel@bnf.fr Le centre de documentation d’Armand Boutillier du Retail : de la légende à l’histoireEn 1925, Armand Boutillier du Retail (1882-1943) crée une bibliothèque d’information économique et technique internationale pour les ministères du commerce et du travail. La bibliothèque ouvre au public en 1932 et intègre en 1938, sous le nom de « Centre de documentation », la réunion des bibliothèques nationales. Ce centre emploiera pendant l’Occupation jusqu’à 400 collaborateurs. Le centre est supprimé en 1945 et ses collections dispersées. Les départements de la Bibliothèque récupèrent les ouvrages qui complètent leurs collections ainsi que les dossiers biographiques, le reste étant dispersé entre la bibliothèque administrative de la ville de Paris, le centre national du Commerce extérieur et les Archives nationales. L’objectif du centre était de constituer des dossiers documentaires, sur des thèmes multiples et de produire des outils pour faciliter les recherches biographiques. Constitués d'articles de presse et de revues, ses « fichiers biographiques » sont d’ailleurs les plus connus. Conservés par le département de la Découverte des collections et de l’accompagnement à la recherche (DCA), ils sont décrits dans le catalogue général, le catalogage de l'intégralité des dossiers conservés au DCA étant une opération en cours, et une partie d’entre eux a été numérisée. En 2020, la mission pour la gestion de la production documentaire et des archives a identifié, au sein des archives du secrétariat général, un ensemble d’archives produit par ce centre de documentation quasiment inédit. Malgré quelques références bibliographiques et l’importance de ses collections, l’histoire de ce centre reste à écrire d’autant que les connaissances actuelles semblent parfois entourées de légendes (documentation élaborée à partir des documents personnels des agents, dossiers épurés à la Libération, rôle politique ou non joué par Armand Boutillier du Retail, etc.). Sources : archives du Centre de documentation (BnF, A41 et A36), archives institutionnelles de la BnF (notamment dossiers de personnel, « dossiers biographiques », archives ministérielles conservées aux Archives nationales (notamment sous-série F/12). Volumétrie : les archives du centre elles-mêmes représentent environ 1,5 mètre linéaire. Pistes de recherche : biographie, histoire culturelle de la Seconde Guerre mondiale, histoire des sciences et techniques, histoire des collections Le reclassement des archives du centre de documentation pourra être envisagé en fonction du profil du chercheur ou de la chercheuse. Contact : Anne Leblay-Kinoshita, cheffe de la mission pour la gestion de la production documentaire et des archives.
|