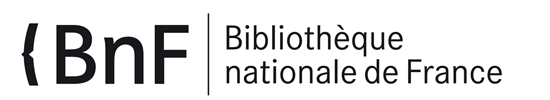|
|
|
1. Appel général : Sujets proposés par les départements > Histoire culturelle, sociale & politiqueLes langues rares du domaine slave de la BnF (XVIe-XXIe siècle)L’aire culturelle slave est abondamment représentée au sein des collections de la Bibliothèque nationale de France (autour de 2 000 ouvrages). Dans cette mosaïque linguistique on compte de nombreux documents imprimés, manuscrits et sonores en langues slaves peu enseignées en France. Cette production reflète l’héritage glagolitique des variantes ancestrales slaves (le vieux-slave et le slavon), ainsi que le patrimoine des minorités linguistiques (à l’instar de la langue sorabe). Le présent projet vise à contribuer au signalement et à la valorisation scientifique de ces fonds rares et méconnus, partagés entre divers départements de la BnF, au moyen du dépouillement systématique d’un appareil bibliographique papier et de ressources spécialisés en ligne. Pistes de recherche : recensement des éditions mal répertoriées (ouvrages liturgiques, recueils de chants religieux et de poésie populaire) ; description fine des documents : datation, provenance, attribution d’un usage et de variantes linguistiques spécifiques ; élaboration d’un corpus éditorialisé dans Gallica dédié aux langues slaves anciennes et minorées. Domaines thématiques : philologie slave, paléo-slavistique, patrimoine glagolitique, langues anciennes, langues minorées, folklore slave. Contacts : Emmanuelle Gondrand, directrice du département Littérature et art Référente scientifique : Yoanna Planchette, chargée de collections en langues et littératures slaves d'Europe centrale et balkanique, département Littérature et art Tracts, libelles, placards : XVIe-XVIIIe sièclesLa Bibliothèque nationale de France conserve en grand nombre des publications occasionnelles – avis, tracts, libelles, placards – qui rapportent et commentent les nouvelles sous forme de petites plaquettes imprimées de quelques pages. Particulièrement fréquentes entre le XVIe siècle et l’essor de la presse périodique au XVIIIe siècle, elles contiennent des récits de batailles, des rapports sur des fêtes publiques, des pronostications astrologiques, des relations de faits sensationnels comme des apparitions, des faits divers ou des événements astronomiques, climatiques ou tératologiques. Souvent produits à bas coût, rarement et chichement illustrés d’images de remploi, considérés comme une littérature de consommation, destinée à être jetée après lecture, ces ouvrages n’ont pas toujours attiré l’attention en raison de leur contenu en apparence anecdotique ou de leur aspect quelque peu fruste. L’événement y est pourtant souvent prétexte à un discours politique, social ou religieux sur les affaires du temps, tandis que leurs caractères matériels interrogent de nombreux aspects de l’histoire du livre : contraintes économiques pesant sur l’édition, copie des textes, recyclage des images, colportage etc. Pistes de recherche : histoire du livre ; histoire de l’information ; histoire des images « populaires » et de la culture visuelle ; histoire politique, sociale, culturelle, scientifique et religieuse de la première modernité ; histoire de la presse (en les faisant dialoguer avec les journaux et almanachs à partir du xviie siècle). Contacts : Jeanne-Marie Jandeaux, directrice du département Philosophie, histoire, sciences de l’Homme 01 53 79 50 50, jeanne-marie.jandeaux@bnf.fr Référent scientifique : Pierre Couhault, adjoint au chef du service Histoire Archives pontificales des canonisationsLa BnF conserve un « fonds des canonisations » (cotes H 601-1396) provenant du transfert d’une partie des archives pontificales à Paris par Napoléon. D’abord déposé aux archives de l’Empire (Hôtel de Soubise), le fonds est transféré en 1862 à la Bibliothèque impériale. Ce fonds contient les pièces des dossiers établis entre 1650 et 1808 pour les procès en béatification et/ou canonisation de 445 personnes, à différentes époques (début du christianisme, époque médiévale, principalement des personnalités ayant vécu entre le XVIe et la fin du XVIIIe siècle). Les dossiers sont composés d’imprimés, d’archives du diocèse, mais aussi de manuscrits (lettres, témoignages, etc.). Un premier travail de recherche et d’inventaire a été mené par Wilhelm Schamoni en 1983, et un second a été débuté par un chercheur associé en 2011-2012 (analyses statistiques, étude plus spécifique de Saint Géri - Gerius). Volumétrie : 796 volumes, 15 mètres linéaires, déjà inventoriés. Pistes de recherche :
Contacts : Jeanne-Marie Jandeaux, directrice du département Philosophie, Histoire, Sciences de l’Homme Référentes scientifiques : Lucie Mailland, cheffe du service Philosophie-Religions ; Claire Camberlein, adjointe à la cheffe de service lucie.mailland@bnf.fr ; claire.camberlein@bnf.fr La presse en anglais publiée en France (1815-1940)Objectif : retracer l’histoire de la presse publiée en anglais en France, de sa légalisation à la Restauration jusqu’à l’invasion allemande en juin 1940. Plusieurs centaines de titres entrés par dépôt légal sont concernés. Il en ressort une grande diversité de thèmes : presse d’information générale quotidienne, presse technique et de brevets, presse boursière et économique, presse de voyage, presse artistique, etc. La plupart des grands genres de la presse y sont représentés, à destination d’un public restreint mais dynamique, composé d’investisseurs économiques mais aussi de séjourneurs fortunés au long cours passant l’hiver sur la riviera ou la côte basque. Comment cette presse accompagne-t-elle l’essor de la grande presse en France, au XIXe siècle et au cours de son âge d’or, et quel rôle y tient-elle ? Quelle articulation avec la presse anglaise publiée outre-manche et diffusée en France ? Quelles sont les relations avec les agences de presse britanniques à Paris et en Europe ? Quelles sont les communautés linguistiques de cette presse, leur contours sociologiques et politiques ? Où résident-elles, quelle est leur influence au-delà de leurs communautés ? Cette presse en anglais entretient-elle des liens avec d’autres presses allophones, italienne et espagnole en particulier ? Permet-elle d’établir un pont avec le « Nouveau Monde » ? Est-elle tournée vers le développement des intérêts français ou britanniques dans les mondes à coloniser durant cette période ? L’objet de cette étude est tout d’abord d’identifier clairement les titres de cette presse, en remontant à ses origines, dès la fin de l’Empire et le début de la Restauration. Il s’agit d’en faire une cartographie, du fait de son éclatement entre de très nombreux départements de la BnF, puis un inventaire exhaustif, avec établissement d’une typologie fine, permettant un classement par genre. Une numérisation a débuté, avec quelques titres déjà présents sur Gallica. Cet inventaire permettrait d’établir des ordres de priorité ainsi qu’un programme de valorisation scientifique sur le web. Une bibliographie à jour est disponible sur le site du groupe de Recherche Transfopress Contacts : Julie Ladant, directrice du département Droit, économie, politique Référent et référente scientifiques : Philippe Mezzasalma, chef du service Presse ; Eugénie Martin, chargée de collections au service Presse philippe.mezzasalma@bnf.fr ; eugenie.martin@bnf.fr Traces du quotidien : les « éphémères », du Second Empire à nos joursLe fonds des Recueils regroupe, dans des domaines très divers, des documents imprimés éphémères tels que tracts, faire-part, dépliants mais aussi agendas, almanachs, règles de jeux de rôles, etc. Il doit son nom à son mode de conservation et de catalogage : les documents, impossibles à traiter à l’unité, y sont réunis en « recueils ». Ceux-ci sont ordonnés suivant un classement variable (chronologique, alphabétique, géographique, etc.) autour d’un sujet ou d’une collectivité éditrice. L’essentiel du fonds contient des documents du Second Empire à nos jours. Il occupe trois magasins soit près de 10 km linéaires. Les principaux types de documents que l’on peut trouver dans les recueils sont les suivants :
Pistes de recherche :
Contacts : Jeanne-Marie Jandeaux, directrice du département Philosophie, histoire, sciences de l’Homme 01 53 79 50 50, jeanne-marie.jandeaux@bnf.fr Référent scientifique : Messali Henniène, chargé de collections « Recueils » La presse dite « indigène », l’autre voix des coloniesObjectif : analyser l’évolution de la voix des peuples natifs de l’espace colonial français via la presse « indigène » (typologie, comparaisons etc.). Ce projet serait le pendant d’un travail en cours à la BnF sur la presse coloniale, c’est-à-dire écrite par et pour les citoyens français des colonies. Il permettrait de faire le lien avec la presse d’immigration sur le territoire français, bien identifiée sur Gallica. Ainsi, par exemple, pour l’Algérie : la production éditoriale officielle, celle de la colonisation comme des différentes sensibilités de la population d’origine Européenne en Algérie, fut si importante qu’elle a tendance à masquer les efforts des Algériens eux-mêmes pour diffuser une expression propre, des plus conservatrices et religieuses comme celle des Oulemas, à la presse nationaliste de Messali Hadj, ou indépendantiste avec les journaux du FLN. Cette expression publique par voie de presse des natifs colonisés a toujours été fragile ou menacée, quel que soit le statut juridique de l’espace colonisé : des départements français d’Algérie aux protectorats de Tunisie et du Maroc, en passant par les gouvernements de l’Indochine, la puissance coloniale a tenté de museler une presse autonome, jugée contraire aux intérêts français. L’inventaire comparé et systématique des titres de presse, pays par pays, sensibilité par sensibilité, quelle que soit la langue utilisée (français ou autre, voir bilingue) et les publics de destination (élites traditionnelles, « jeunes Turcs » membres de l’enseignement ou de l’administration coloniale, professions libérales et médicales) permettra d’identifier plus facilement ces titres, de mesurer leur influence dans le temps et l’espace (avec pour certains une circulation jusqu’en métropole chez des colonisés venus y travailler), et enfin de pouvoir en dresser une typologie ouvrant les champs de l’analyse. L’inventaire pourra ouvrir vers d’autres collections que celles de la BnF, pour les journaux interdits et non entrés par le dépôt légal ou les services de l’État. Pistes de recherche : comment la presse indigène porte-t-elle la voix des peuples natifs ? Dans quelle mesure contribue-t-elle à la préservation des cultures ancienne comme à la naissance d’une conscience nationale ? Quel est son prolongement sur le sol de la métropole, via la presse d’immigration ? Comment la comparer à la presse coloniale ? Limites géographiques proposées : espace colonial français (Ex-AOF, Ex-AEF, Madagascar, Ex-Indochine, Algérie, Maroc, Tunisie) Limites temporelles proposées : années 1890-1950 Contacts : Julie Ladant, directrice du département Droit, économie, politique Référent scientifique : Philippe Mezzasalma, chef du service presse Les débuts de la presse jeunesse, des années 1930 à Pif-GadgetObjectif : retracer l’histoire de la presse « jeunesse » dans sa spécificité, distinguée de la presse « enfantine ». Identifiée jusque-là de manière générique sous le terme de « presse enfantine », sous-entendu une presse non destinée aux adultes, la presse « jeunesse » a longtemps été noyée dans un ensemble hétéroclite et trop vaste mêlant La Semaine de Suzette et Pilote, Cœur Vaillant et Salut Les Copains ! Depuis la reconnaissance des contre-cultures du deuxième vingtième siècle comme objet patrimonial majeur, et sa relation avec les publics « jeunes », ceux-ci ont été délimités plus strictement à l’adolescence, avec ses thématiques propres (pop culture, sexualité, musiques rock ou rap, etc.) et aux organisations et cercles sociaux dédiés : auberges de jeunesse, scoutisme, maisons de la jeunesse et de la culture, foyers de jeunes travailleurs, soit un monde associatif structurant cette tranche d’âge et émettant sa propre presse. Les 10-15 ans sont même détachés des 16-20 ans vers 1977, lorsqu’Okapi revoit sa ligne éditoriale, désormais tournée vers les thèmes de l’écologie, de l’urbanisme, du nucléaire, à destination non plus des enfants mais des collégiens. Les 16-20 ans se retrouvent alors sollicités par des magazines de bandes dessinées, ou satiriques, initialement prévus pour des jeunes adultes comme Métal Hurlant ou Fluide Glacial. Or, si la presse enfantine est de mieux en mieux connue et identifiée, y compris dans les collections de la BnF, la presse pour « jeunes » (adolescents) constitue un domaine moins étudié. L’objet de cette recherche serait tout d’abord d’identifier les titres de cette presse, d’en remonter l’histoire, bien avant l’explosion des années 1960, et d’en faire un inventaire exhaustif, cartographiant des collections très dispersées au sein de la BnF. Cet inventaire servira à améliorer la conservation et la sûreté de ces collections (reliure, numérisation) mais aussi à en compléter les lacunes par acquisitions. Une valorisation dans Gallica pourra également être proposée. Cette recherche accompagnera et complètera ainsi la valorisation en cours de la presse alternative, les deux presses partageant beaucoup de points communs. Limites géographiques proposées : France, presse française, presse francophone Limites temporelles proposées : années 1930-1980. Pistes de recherche : comment la presse accompagne-t-elle l’émergence de la figure du « jeune », de l’adolescent ? Quand la presse enfantine et la presse jeunesse se séparent-elles, et quelles en sont les prémices ? Fanzines, magazines, bandes-dessinées : quels sont les lieux d’expression et d’informations de la jeunesse ? Ces questionnements structurent un nouveau champ de recherche qui mobilise aujourd’hui grands témoins et protagonistes, éditeurs, collectionneurs et chercheurs, académiques ou non. Contacts : Julie Ladant, directrice du département Droit, économie, politique Référente scientifique : Alexia Bauville, adjointe au chef du service presse Les études de marché et de groupe des années 1960 à nos joursLa BnF conserve des milliers d’études de marché réalisées par des cabinets d’études français ou étrangers, des organismes professionnels, des institutions ou des éditeurs. Si le fonds porte majoritairement sur le marché français, il comprend aussi des études relatives à d’autres pays et au marché mondial. Les collections comportent la production de grands cabinets comme Dafsa-Eurostaf, Xerfi, les Échos, mais aussi des cabinets plus spécialisés comme Idate, MSI reports, Gira Conseil, IPEA, IWSR-Wine Intelligence, Ak-a, etc. La BnF conserve aussi des études de groupe qui analysent le fonctionnement et la structure organisationnelle de grandes entreprises dont les plus anciennes remontent aux années 1960. Le mode d’entrée de ces études à la BnF est triple. Les premières études sont reçues à partir des années 1960 par dépôt légal. A ce mode d’entrée s’ajoutent les acquisitions du Pôle de ressources et d’information sur le monde de l’entreprise (PRISME) créé en 1996 au sein de la BnF. De façon marginale, des études ont aussi pu intégrer les collections par don. Ce fonds permet de documenter la plupart des secteurs d’activité des années 1960 à nos jours : le conseil, l’alimentation, les banques et les assurances, l’industrie ou encore l’informatique sont autant de domaines couverts. En ce sens, il s’agit d’une source précieuse pour l’histoire des entreprises et plus largement, pour toute recherche ayant trait à l’histoire économique et sociale de la seconde moitié du XXe siècle et du XXIe siècle. C’est également un matériau pour l’histoire de la consommation au regard de l’analyse des besoins des clients et des pratiques de consommation qui y sont réalisées. Enfin, les études sur le marché mondial pourront être mobilisées pour une histoire économique des relations internationales. Plusieurs pistes de recherche peuvent être envisagées pour l’étude de ce fonds. Fonds composite dispersé entre plusieurs départements de la BnF et dont le signalement au catalogue général est hétérogène, il pourra faire l’objet d’un inventaire afin d’en saisir plus précisément le périmètre. Une étude monographique se concentrant sur un secteur d’activité en particulier pourra aussi être proposée sur des champs aussi variés que la santé, l’industrie, le luxe, le secteur bancaire, l’agroalimentaire, la construction immobilière, etc. Contacts : Julie Ladant, directrice du département Droit, économie, politique Référent scientifique : Benjamin Prémel, chef du service économie-PRISME
|